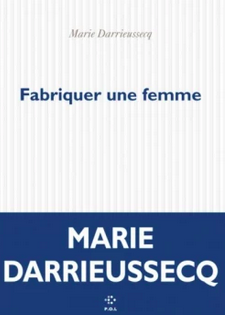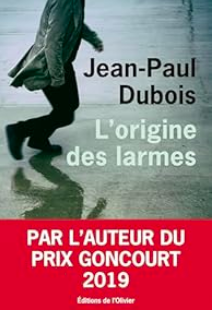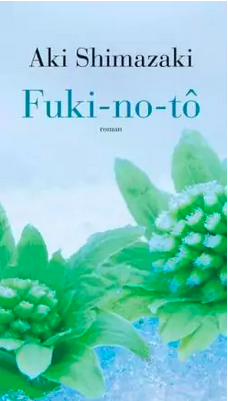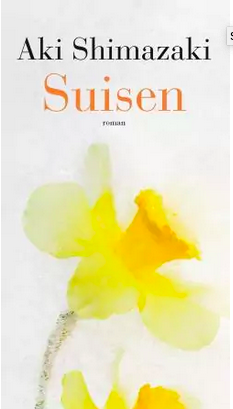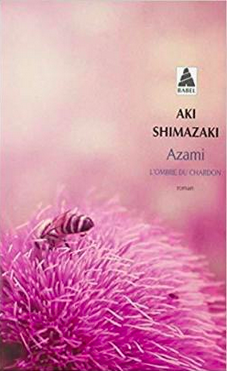Petite référence à la Souche pour ce nouveau livre d’Edouard Louis que sa maman a peut-être surnommé Doudou dans l’enfance. En tout cas, elle l’appelle un soir au secours car elle n’en peut plus de l’homme avec qui elle habite. Le livre s’appelle Monique s’évade et c’est bien de cela qu’il va s’agir. L’écrivain est alors en résidence en Grèce quand survient ce coup de fil inquiétant, sa mère est en danger car le mec est violent quand il est bourré et il l’est tout le temps.
Pourtant, tout avait bien commencé. Monique, la mère d’Edouard Louis donc, avait viré son mari, le père d’icelui, assez brutalement puis était venue vivre à Paris, histoire racontée par le fils, tout allait bien, elle avait même rencontré Catherine Deneuve, elle qui sortait d’un trou à rat. Hélas, ce nouveau compagnon peu à peu devient un tel cauchemar et une telle menace qu’il faut agir vite. Alors le fils appelle ses amis à Paris et ce sont eux qui vont aider la dame, l’accueillir, l’installer dans l’appartement de son fils, lui acheter des provisions et lui prêter de l’argent. Puis Edouard Louis va téléguider, par téléphone, la suite des événements, c’est difficile et stressant. Il faut aussi qu’il demande de l’aide à sa sœur avec qui est fâché depuis dix ans, mais les choses se font…
Plein de petits détails sur la vie de la maman nous sont narrés, ses goûts, ses teintures, ses désirs. Et puis surtout, et ça n’est pas rien, il la décrit quand elle devient l’héroïne de sa propre histoire (celle où elle se métamorphose) sur une scène de théâtre et qu’elle monte sur scène où elle est acclamée. Quelle revanche !
L’histoire n’est pas banale, certes, l’écrivain se montre sous le jour du bon fils, revient sur toutes les critiques qu’il avait émises sur sa mère, sa violence notamment dans Eddie Bellegueule, explique pourquoi elle ne pouvait qu’être ainsi face à la violence du mari, de leur pauvreté et de leur croupissement dans leur trou du nord où aucun espoir d’amélioration ne pouvait s’envisager.
C’est un court récit un peu paresseux (je trouve), pas très creusé car apparemment l’écrivain était sur un autre projet (son frère) mais malgré tout suffisamment intéressant « sociologiquement » pour que les médias en parlent avec enthousiasme. Les problèmes de transfuges de classe, ils aiment bien, les médias actuellement. Mais c’est bien quand même, si, si…
Monique s’évade d’Edouard Louis. 2024 aux éditions du Seuil. 170 pages, 18 €
texte © dominique cozette